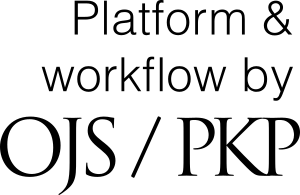Call for papers
ECHO – Revue Interdisciplinaire de Communication. Langages, cultures,
sociétés
CFP numéro 7/2025, sous la direction de Martina Basciani, Federico Gabriele
Ferretti, Elena Lamberti
Intelligences AlterNatives
Formes et pratiques des résurgences indigènes mondiales
This process is collectively individual, creating islands of radical resurgence. Simpson 2017, p. 194
“I am interested in freedom, not survival” (Simpson 2017: 45). Avec ces mots, l'universitaire et artiste Mississauga Nishnaabeg Leanne Betasamosake Simpson ravive un débat de longue date sur les luttes culturelles et politiques des peuples autochtones. À partir de 1876, année de la promulgation de la « Loi sur les Indiens » ou Indian Act, les Premières nations du Canada ont assisté à l'institutionnalisation de la violence du colonialisme de peuplement (settler colonialism) sous la forme de la saisie progressive des terres et de la création de pensionnat autochtone, principaux promoteurs du génocide culturel qui a frappé les traditions indigènes. La résistance des générations indigènes précédentes a permis à ces cultures d'arriver jusqu'à nos jours, sous la forme de graines contenant une révolution ; le temps de la survie aux ravages du colonialisme est maintenant terminé : le temps de la Résurgence est venu.
Définie comme un mouvement culturel et politique qui se concentre, dans un premier temps, sur la régénération des langues menacées et des traditions spirituellement ancrées, dans le but ultime de réaffirmer la souveraineté indigène, la Résurgence doit être comprise, selon Simpson, comme «une lentille, une analyse critique, un ensemble de connaissances théoriques et une plateforme d'organisation et de mobilisation qui a le potentiel de transformer merveilleusement la vie sur Turtle Island [la terre indigène correspondant à l'Amérique du Nord dans la philosophie Anishinaabe] “ (2017: 49, notre traduction). Le mouvement de la Résurgence est sous-tendu par la valeur accordée aux récits traditionnels, qui peuvent rétablir et renforcer l'identité autochtone à l'époque actuelle. Les histoires, véhicules des connaissances ancestrales transmises de génération en génération, ne sont plus seulement transmises oralement, mais se diffusent également par l'écriture et d'autres moyens de communication. Ainsi, elles contribuent de manière de plus en plus pervasive à adapter les enseignements du passé à la modernité, offrant des lignes directrices essentielles pour l'activisme politique. La Résurgence indigène se situe donc naturellement à l'intersection de diverses questions qui, en raison de la nature même du phénomène analysé, sont susceptibles d'intéresser des experts de différentes disciplines, des études culturelles, linguistiques et littéraires à l'histoire, de la sociologie à la politique.
Si les récits de la tradition transmettent les connaissances ancestrales au présent, contribuant ainsi à imaginer des avenirs allochtones pour les peuples autochtones, la dimension de la résurgence doit, en fait, être a-temporelle ou, comme l'exprime la philosophie anishinaabe, biskaabiiyang (Geniusz, 2009 ; Simpson, 2011 ; 2017). Traduit littéralement par « le processus de retour à nous-mêmes » (Simpson, 2017 : 17 ; notre traduction), le temps biskaabiiyang entrelace le passé, le présent et le futur pour donner naissance à une réalité différente, décoloniale et profondément autochtone. De même, l'auteure Nishnaabeg Grace Dillon définit un tel instrument d'effondrement temporel avec le terme « Indigenous slipstream “, décrivant le temps de la Résurgence comme ” des passés, des présents et des futurs qui s'écoulent ensemble comme les courants d'un ruisseau navigable... » (2012 : 345, notre traduction). La question des futurismes indigènes émerge donc comme une autre question de nature multidisciplinaire : l'arrivée des récits indigènes dans les environnements digitales a conduit à la prolifération de plateformes éducatives en ligne, telles que Biskaabiiyaang: The Indigenous Metaverse (www.biskaabiiyaang.com), ou Four Directions Teachings (www.fourdirectionsteachings.com, Wemigwans, 2018), ainsi que des jeux vidéo fortement axés sur des thèmes indigènes tels que Until Dawn ou Never Alone (Byrd, 2021), et continue de se rapporter aux dernières technologies, telles que l'IA. Démontrant que les environnements numériques, et en particulier les médias sociaux, sont étroitement liés à la Résurgence indigène à l'échelle mondiale, on peut également citer les mouvements de protestation sociopolitiques individuels tels que Idle No More et #NoDAPL au Canada et dans le Dakota du Nord respectivement, We Are Oceania (WAO) en Australie et en Nouvelle-Zélande et le Movimiento Nacional de los Pueblos Indígenas au Mexique, entre autres, ainsi que le nombre croissant d'activistes numériques dénonçant le travail néocolonial actuellement en cours en Palestine.
La Résurgence vise en fin de compte à construire un réseau mondial de solidarité indigène. Qualifiant l'internationalisme indigène (Indigenous Internationalism) d'élément central de son programme politique, Simpson (2017) envisage l'instauration de relations éthiques entre les nations indigènes humaines, animales et végétales, à l'échelle mondiale. L'idée derrière l'internationalisme indigène, selon l'auteure, est que les singularités indigènes ne sont pas perçues comme des monolithes, mais plutôt comme des îles unies par un but unique, décolonial et résurgent. On se souvient, consciemment ou inconsciemment, de la métaphore de l'archipel fournie par l'érudit caribéen Édouard Glissant, qui met l'accent sur les liens relationnels et non hiérarchiques entre des cultures spécifiques dotées d'une spécificité intrinsèque (1990). À cet égard, Gloria Anzaldúa propose le concept de nepantla chicano - décrit comme « l'espace entre les mondes » - dans son ouvrage phare Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987/2022) ; de même, l'écrivaine amérindienne d'origine Laguna Leslie Marmon Silko contribue à l'idée de tribalisme mondial en imaginant « un monde, de nombreuses tribus » dans son ouvrage The Almanac of the Dead (1991). L'internationalisme indigène, l'archipel, nepantla et le tribalisme mondial montrent comment, au-delà des frontières géographiques ou imposées, il est nécessaire d'établir une relation éthique, une résistance au (néo-)colonialisme et la promotion de résurgences indigènes mondiales.
L'objectif de ce numéro est d'explorer les différentes déclinaisons des résurgences indigènes qui se manifestent à l'échelle internationale, transcendant les frontières établies entre les continents et les disciplines académiques. Les propositions qui actent une lecture transmédia et transdisciplinaire des résurgences indigènes dans les Amériques, l'Océanie, l'Europe, la Palestine et le reste du monde seront particulièrement bienvenues. Le numéro accepte les contributions de nature culturelle, linguistique et littéraire, mais aussi historique, sociologique, politique et géographique.
Les idées de recherche possibles incluent, mais ne sont pas limitées à :
● Survie vs Résurgence dans une perspective diachronique et/ou comparative.
● Histoire coloniale des contextes de résurgence : récupérer le passé pour comprendre le présent et imaginer des avenirs allochtones.
● Le récit, le mythe, la tradition et l'orature.
● L'activisme politique des résurgences (en ligne/hors ligne/hybride).
● Les temporalités indigènes et « la fin du monde ».
● Les productions artistiques, culturelles, littéraires, et multimodales des résurgences
● Projets de revitalisation linguistique (en ligne/hors ligne/hybride)
● Espaces de résurgence : des métropoles aux réserves, en passant par les environnements numériques.
● La contribution de l'IA aux résurgences indigènes
● Les relationnalités indigènes dans le monde.
Échéances :
Résumé (500 mots) : 10 mars 2025
Notification d'acceptation : 14 avril 2025
Soumission de l'article : 25 juin 2025
Publication : 30 novembre 2025
Longueur de l'article : max 7000 mots
Pour proposer un article, écrire à : rivista.echo@uniba.it
Bibliographie de référence essentielle
Anzaldúa, G. 2022. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987), 5th ed., Aunt Lute Books, San Francisco.
Byrd, J. 2017. Playing Stories: Never Alone, Indigeneity, and the Structures of Settler Colonialism. Cornell University. (https://www.cornell.edu/video/jodi-a-byrd-video-games-indigeneity-settler-colonialism)
Carbonara, L. 2020. Dances with stereotypes. Ombre Corte edizioni, Verona.
Clifford, J. 2013. Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Cambridge.
Dillon, G. 2012. Walking the Clouds: An Anthology of Indigenous Science Fiction, University of Arizona Press, Tucson.
Estes, N. 2019. Our History Is the Future, Verso Books, London, New York.
Geniusz, W. D. 2009. Our Knowledge is Not Primitive: Decolonizing Botanical Anishinaabe Teachings. Syracuse University Press, New York.
Glissant, É. 1990. Poétique de la relation. Gallimard, Paris.
Silko, L. M. 1991. The Almanac of the Dead. Simon and Schuster, New York.
Simpson, L. B. 2011. Dancing on Our Turtle’s Back: Stories of Nishnaabeg Re-Creation, Resurgence and a New Emergence. ARP Books, Winnipeg.
Simpson, L. B. 2017. As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance. University of Minnesota Press, Minneapolis.
Wemigwans, J. 2018. A Digital Bundle: Protecting and Promoting Indigenous Knowledge Online. University of Regina Press, Regina.
Whitehead, J., ed. 2020. Love after the End: An Anthology of Two-Spirit & Indigiqueer Speculative Fiction. Arsenal Pulp Press, Vancouver.
Zaccaria, P. 2017. La lingua che ospita. Meltemi, Milano.